Issu de la seconde vague emo qui déferle sur les Etats-Unis au beau milieu des années quatre-vingt dix, The Get Up Kids va sans le savoir – et avec l’aide de formation tels que Jawbreaker, Mineral, Sunny Day Real Estate, Knapsack, The Promise Ring, ou encore Jimmy Eat World – faire partie des chefs de file de ce mouvement musical (aussi appelé indie emo ou emo indie) et participera à son développement tout au long de ses dix années d’existence en produisant quatre excellents albums ainsi que quelques EP’s.
C’est en 1995 à Kansas City que Matthew Pryor (chant / guitare), Jim Suptic (guitare / chant), Rob Pope (basse), et Nathan Shay (batterie) décident de monter The Get Up Kids suite à diverses autres aventures musicales peu fructueuses. Très vite le groupe se met à composer et commence à mettre de l’argent de côté afin d’enregistrer son premier EP. Très peu emballé par la vie de tournée, Nathan Shay quitte l’aventure et sera rapidement remplacé par le petit frère de Rob, Ryan Pope. A partir de ce moment là, le groupe ne connaîtra plus aucun changement de line-up, mis à part l’arrivée de James Dewees (Coalesce) aux claviers en 1999.
Peu de temps après l’arrivée de Ryan derrière les fûts, le groupe signe avec Doghouse Records (Hot Water Music, Chamberlain, Eleven Eleven, As Friends Rust), qui sortira le premier EP du groupe, l’excellent Woodson. La machine est en marche …
Four minute mile est enregistré en deux jours sous la houlette de Bob Weston (Shellac) en avril 1997, et est à mon avis un véritable concentré d’émotions brutes qui, malgré ces dix années, n’a pas pris une seule ride.
Comme je l’ai mentionné un peu plus haut, cet album a été enregistré en deux jours, donc ne vous attendez pas à un son hyper propre ainsi qu’à une production léchée. Le groupe a simplement branché les instruments, envoyé la sauce et basta. Pas de gros effets, ni de prises individuelles : juste un groupe qui balance sur bande ce qu’il a sur le cœur.
A mon avis, cette production un brin cradingue ne fait que renforcer l’impact émotionnel et la sensation d’urgence qui se dégage de ces compositions. Il arrive donc d’entendre quelques ratés ou autres larsens de temps à autres, mais cela n’altère en rien la qualité des titres, et change un peu de ces albums au son si retravaillé que les morceaux en deviennent plats comme une crêpe.
Mais assez bavassé, entrons vite dans le vif du sujet et passons en revue les onze titres qui composent cette magnifique galette.
L’album débute à fond les manettes avec Coming clean, qui annonce la couleur dès les premières notes : des guitares à la fois énervées et mélodiques, une batterie qui cavale à fond la caisse, charleston grand ouvert, une basse ronronnante à souhait – limite saturée –, et un chanteur qui éructe sa parole du plus profond de ses tripes. En deux minutes et des brouettes, le groupe nous balance un morceau monstrueux qui part dans tous les sens, ponctué ça et là de quelques accalmies mélodiques et rythmiques.
Don’t hate me ralentit un poil le tempo et introduit quelques passages accompagnés d’un moog, qui n’est pas sans rappeler certains passages de l’excellent Pinkerton de Weezer. Le titre gagne en puissance au fil qu’il évolue pour atteindre son apogée vers la deuxième minute, avant de se terminer sur quelques notes en arpège qui accompagnent la voix de Matthew, qui se fait subitement plus douce.
Place ensuite à l’excellent Fall semester, qui débute sur quelques notes de guitares en son clair avant de gagner progressivement en intensité mélodique, pour ensuite transporter l’auditeur sur un véritable nuage où les deux guitaristes se livrent à un échange de pickings franchement planants. Alors que Matthew susurre presque ses paroles au fil des notes de guitare, on se dit que le titre va se terminer ainsi, mais que nenni : le morceau se termine sur une véritable montée en puissance qui atteint son sommet aux alentours des deux minutes trente, et qui refilera la chair de poule aux plus durs d’entre vous.
C’est au tour du brûlot Stay gold, ponyboy de pointer le bout de son nez, et là encore on s’en prend plein les oreilles. Une fois de plus, le titre part dans tous les sens et gagne graduellement en intensité – notamment en évoluant en diverses structures toutes aussi différentes les unes que les autres, mais en gardant toujours le même fil conducteur mélodique –, avant d’exploser et de se terminer sur quelques notes de guitare.
Petit moment de répit avec le très bon et envoûtant Lowercase west thomas, qui permet à l’auditeur de retrouver ses esprits et de faire tomber un peu la pression.
L’accalmie sera de courte durée, car Washington square park débarque, accompagné de ses guitares survoltées et sa rythmique punk hyper énergique. Matthew et James se partagent le micro en balançant des lignes de chant à la limite de la rupture, alors que l’auditeur ne sait plus où donner de la tête face à cette succession de riffs et de changements de rythme. Le petit break au milieu du morceau ne fait d’ailleurs que renforcer la montée qui suit, et qui met littéralement tout le monde à genoux.
Le groupe ne semble toujours pas vouloir lever le pied avec Last place you look, qui débute un peu de la même façon que Don’t hate me, mais qui se mue très vite en un véritable hymne punk-rock avant de ralentir à nouveau le tempo et de faire les yeux doux aux guitares en son clair. Les cinquante dernières secondes du morceau sont, quant à elles, une véritable décharge d’adrénaline, car entre la prestation vocale chargée de hargne de Matthew et le déluge sonore qui l’accompagne (la partie de guitare de James est tout bonnement hallucinante, sans parler du jeu de Ryan, qui est à la fois rapide et précis), on a du mal à comprendre ce qui nous arrive.
Avec Better half, le groupe change la donne et propose un morceau nettement plus calme et aérien, mais toujours ponctué de quelques soubresauts plus énervés par-ci, par-là. Une ballade qui passe comme une lettre à la poste.
No love est peut-être le titre le plus linéaire de la galette, mais il n’en reste pas moins d’excellente qualité. On retrouve toujours cette urgence et cette hargne qui se mélange à des passages un poil plus calmes et mélodiques.
Shorty peut être comparé à Stay gold, ponyboy et à Last place you look au niveau des guitares – totalement débridées et balançant une avalanche de riffs – et de sa rythmique qui galope à trois cent à l’heure en proposant moult variations. Le chant est quant à lui vraiment poussé dans ses retranchements et nous offre une prestation de Matthew (toujours accompagné de James par moments) tout simplement bluffante, qui déborde d’émotions et de sincérité, surtout sur la dernière minute du titre.
Michelle with one L clôt les hostilités en douceur et en beauté. La voix se fait plus douce, presque chaleureuse, alors que les guitares se livrent à une véritable partie de cache-cache entre son clair et saturé. Le passage au piano qui s’immisce en milieu de titre est prenant à souhait et vous fera frissonner, avant de s’effacer lorsque les dernières attaques de guitares font leur apparition.
Puis le silence. On est presque hébété, car en moins de trente cinq minutes, le groupe à réussi à nous en mettre plein les oreilles avec des titres hyper bien construits et ficelés. Aucun temps mort, pas de remplissage, cet album est une véritable mine d’or proposant des morceaux directs et qui vont droit au but. L’énergie, la hargne, et la sincérité qui se dégage de ces onze compositions gomment sans problème les petits défauts (son parfois approximatif et brouillon, chant pas forcément toujours juste) qui jonchent l’album ça et là.
Je crois que je ne
vais pas encore blablater pendant des plombes pour conclure cette chronique, car je me rends compte que je me suis un peu laissé emporter – et je m’en excuse d’avance –, mais j’espère juste avoir réussi à titiller la curiosité de ceux qui ne connaissent pas encore ce magnifique album, et à rendre hommage à cette pièce maîtresse du mouvement emo.
- coming clean
- don’t hate me
- fall semester
- stay gold, ponyboy
- lowercase west thomas
- washington square park
- last place you look
- better half
- no love
- shorty
- michelle with one l


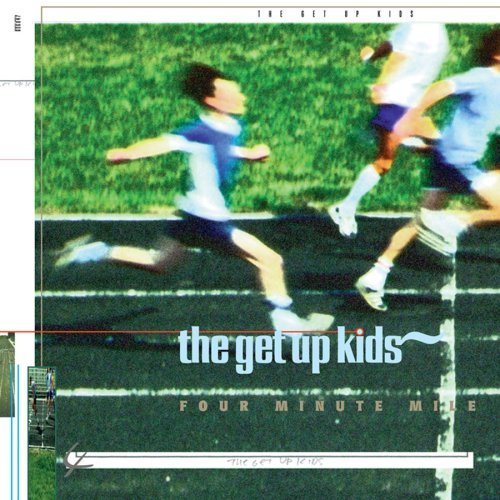




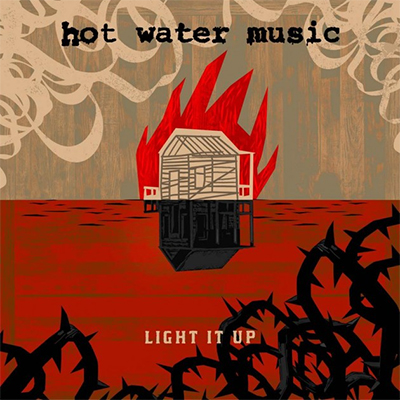

Ca fait plaisir de lire cette chronique. Il manque juste le nom de Texas Is The Reason parmis les groues marquant de l’époque et tout y est en effet ;)
Je viens de découvrir cet album il y a quelques temps. Il est bien loin quand même l’époque où l’on faisait encore du bon vieux punk/emo. Quand on voit les productions actuelles, on a qu’une seule envie : faire un bond en arrière de quelques années.
Dommage que les albums qui suivirent n’eurent pas la hargne de Four Minute Mile.